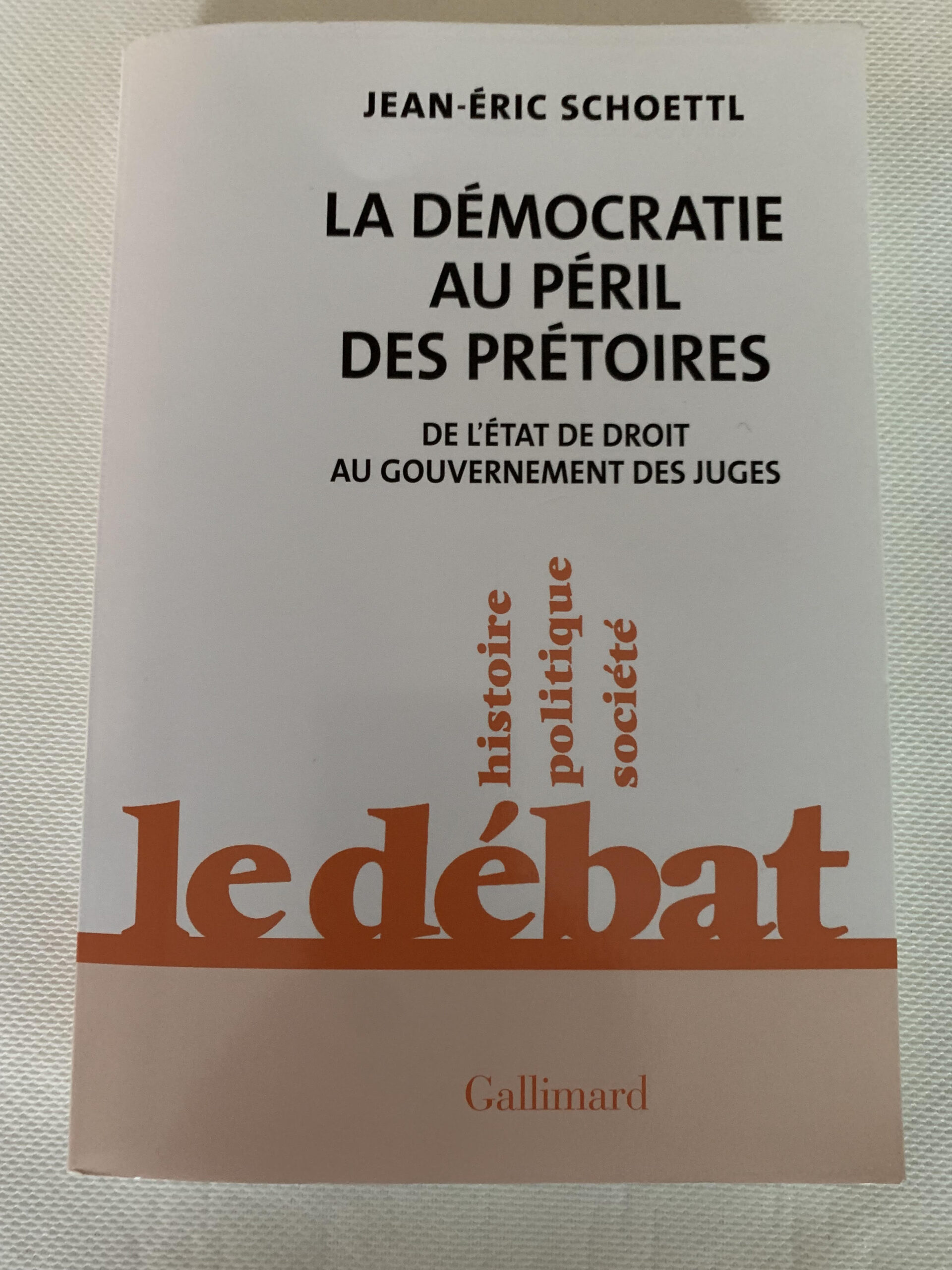Conférence de Jean-Eric SCHOETTL -26 Janvier 2023
La Démocratie au péril des prétoires
Depuis la parution de mon livre, mes amis me demandent souvent : comment l’ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel que tu es peut-il en arriver à dénoncer la toute-puissance du pouvoir juridictionnel ? N’est-ce pas brûler ce que tu as adoré ?
Je réponds que, bien au contraire, j’ai tenté dans ce livre d’exprimer une conviction qui m’a toujours habité, conviction selon laquelle :
- Le juge doit occuper sa juste place dans le jeu démocratique de la séparation des pouvoirs ;
- Il doit exercer tout son office, mais rien que son office ; assumer la plénitude de ses prérogatives, non les outrepasser.
*
Comment contester que, depuis quelques décennies, la tendance est non à la retenue du juge mais - qu’on le déplore ou qu’on s’en réjouisse - à l’accroissement de son emprise ?
L’extension du contrôle juridictionnel est en grande partie l’œuvre du constituant (institution de la « question prioritaire de constitutionnalité » en 2008, autorisation de ratifier les traités euroipéens…), ainsi que du législateur (référé libertés).
Dans cette mesure, elle a été largement consentie par le politique.
Mais elle est aussi le fait du juge lui-même.
C’est ainsi que le Conseil constitutionnel a décidé en 1971 qu’il contrôlerait la conformité de la loi à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, au Préambule de la Constitution de 1946 et aux « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ».
Ainsi encore, le Conseil constitutionnel a pris sur lui d’enjoindre au juge du fond, en 1975 (IVG), d’écarter la loi contraire au traité, même lorsqu’elle lui était postérieure.
Ainsi toujours, en 2020, il s’octroie le pouvoir de contrôler, au regard des droits et libertés constitutionnellement garantis, les ordonnances non ratifiées (lesquelles contribuent aujourd’hui, pour une part substantielle, à la production normative).
*
Mon livre tente de rendre honnêtement compte d’une évolution dont j’ai été témoin de l’intérieur.
Oui, je pense que la démocratie représentative souffre aujourd’hui de l’hypertrophie du pouvoir juridictionnel, national et supranational, et que nous traversons, depuis un demi-siècle, une crise qui n’est pas sans rappeler celle qu’a connue l’ancien régime avec ses parlements.
L’emprise croissante du juge sur la démocratie revêt deux aspects distincts, quoique non étrangers l’un à l’autre :
- Le droit se construit désormais de plus en plus en dehors de la loi, voire contre elle ;
- La judiciarisation de la vie publique prend des proportions paralysantes.
Ces deux aspects sont liés car ils conduisent tous deux à la dégradation de la figure du Représentant :
- Le premier en restreignant toujours plus étroitement sa latitude décisionnelle ;
- Le second en faisant du Représentant un perpétuel suspect.
Ce qu’on observe en effet depuis un demi-siècle :
- c’est que le pouvoir du juge s'exerce de plus en plus intensément sur les actes des élus (lois) et de l’exécutif (actes réglementaires et individuels)
- et que, au travers de la pénalisation de la vie publique, il s'exerce de plus en plus impérieusement sur la personne de nos représentants (voir, au cours de la période écoulée : l’affaire Fillon, l’affaire Sarkozy/Herzog, la mise en cause de ministres lors de la crise sanitaire ou les poursuites contre l’actuel garde des sceaux pour prise illégale d’intérêts).
Le malaise qui débilite aujourd’hui la démocratie me paraît se situer en partie là : dans l’abaissement du Représentant, dans le rétrécissement de la souveraineté populaire, dans la rétraction de l’autorité de l’Etat, dans l’humiliation des responsables publics.
L’affaiblissement de l’Etat résultant de tous ces phénomènes provoque en effet des réactions allergiques dans le corps social : perte de confiance, abstention, incivisme, populisme, illibéralisme.
*
On objectera que l’affermissement de la fonction juridictionnelle, s'exerçant sur toutes les catégories d'actes des pouvoirs publics et sur les personnes de nos dirigeants, conduit à davantage de rigueur et de transparence dans le fonctionnement démocratique ; qu’elle nous met à l’abri d’aventures antidémocratiques…
C’est vrai en bonne partie.
Mais, pour une part non négligeable, cette évolution a remplacé le caprice du prince par le caprice du juge.
Je ne pose pas ce diagnostic d’un cœur léger. Il y a encore dix ans, je n’aurais pas imaginé faire un tel constat publiquement, ni même dans mon for intérieur.
La critique comporte sa part d’autocritique. Elles sont toutes deux le produit d’un examen de conscience.
Cet examen consiste à se poser systématiquement deux questions à propos de décisions juridictionnelles ayant un fort impact sur des politiques publiques ou sur des titulaires de fonctions publiques, y compris à propos de décisions dans lesquelles on a « trempé » :
Première question : même lorsque la solution retenue paraît satisfaisante moralement ou philosophiquement, est-ce bien au juge, plutôt qu’aux représentants élus de la Nation (ou au gouvernement responsable devant ceux-ci), de l’imposer à la société ?
- Est-ce au juge, plutôt qu’aux représentants élus de la Nation, de décider si l’insémination post mortem, c’est-à-dire par emploi des gamètes du mari défunt, doit être ou non possible (CE) ?
- Ou si le changement de genre doit être enregistré par l’Etat-civil à la seule demande de l’intéressé et sans production d’un certificat médical (CEDH) ?
- Ou si le regroupement familial des étrangers est de droit (CC)?
- Ou si l’accès à l’université doit être gratuit et ne peut faire l’objet que de droits d’inscription modiques (CC) ?
- Ou si la faculté de garder le silence doit être notifiée à la personne gardée à vue (CC) ?
- Ou si les drones utilisés par la police lors de manifestations doivent ou non permettre d’identifier les fauteurs de trouble (CC) ?
- Ou si la CSG peut ou non être progressive (CC) ?
Sur tous ces sujets, la norme a été fixée non par un Parlement, mais par une cour (CEDH, CE ou CC).
La seconde question porte sur les critères du contrôle et les modalités de l’appréciation juridictionnelles :
Le juge n’a-t-il pas cédé, en arrêtant telle ou telle solution, à la pente contemporaine qui, sous l’effet conjugué de divers facteurs (caractère de plus en plus émotionnel et médiatisé des controverses, action des groupes de pression, primauté du ressenti individuel sur les disciplines collectives …), sacrifie l’intérêt général à une sensiblerie droits-de-l’hommisme exacerbée ?
N’a-t-il pas été habité par une vision de l’Etat de droit qui, par réaction contre la séculaire raison d’Etat, ne veut plus entendre que les raisons d’Antigone et récuse celles de Créon ? Oubliant, comme le disait Albert Camus, qu’« Antigone a raison, mais Créon n'a pas tort » ?
Pour reprendre les deux premiers exemples précédents (dons de gamètes post mortem et regroupement familial) : la référence au « droit à une vie privée et familiale » (article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales) suffisait-elle à fonder la solution ? Le juge n’a-t-il pas plutôt exploité une notion juridique vague pour faire prévaloir ses préférences philosophiques et relayer l’air du temps ?
Plus généralement : quelle est la part du conformisme, de l’idéologie, du préjugé et de l’hubris, dans la position du juge ?
*
Je ne veux pas être injuste avec la justice : elle fait souvent preuve de modération (self restraint).
Ainsi, certaines décisions récentes, à l’inverse de celles que je critique dans mon livre, témoignent de la retenue du juge dans le contrôle, l’interprétation et l’application de la loi.
Citons-en trois :
- Le 10 novembre, le Conseil constitutionnel juge qu'il ne lui appartient pas de substituer son appréciation à celle du législateur sur les conditions dans lesquelles un médecin peut écarter les directives anticipées d'un patient en fin de vie, hors d'état d'exprimer sa volonté (directives qui tendaient, en l’espèce, à son maintien en vie en toute circonstance). C’est l’affaire Zhora.
- Le 19 janvier dernier, la CEDH estime que la France n’a pas porté à la liberté de circulation une atteinte contraire à la Convention en assignant à résidence l’islamiste David Pagerie.
- Le 20 janvier, dans l’affaire du covid, la Cour cassation annule la mise en examen prononcée contre Agnès Buzyn par la commission d’instruction de la Cour de justice de la République du chef de mise en danger de la vie d’autrui.
Cependant, la retenue observée dans ces trois décisions est souvent battue en brèche depuis quelques décennies.
Même dans ces trois affaires, la retenue du juge – à y regarder de près - est relative :
- S’agissant de l’affaire Zhora (directives anticipées tendant au maintien en vie coûte que coûte), le Conseil constitutionnel se garde de concéder à l’intérêt général que, dans l’état de nos hôpitaux, il serait simplement inconcevable, comme le dit Denys de Béchillon dans l’Express, que « la volonté d’un quasi-mort enlève aux vivants une chance de meilleur soin, si ce n’est de survie ». Le Conseil ne soulève même pas la question dans sa décision.
- S’agissant de la lutte contre le terrorisme, la CEDH continue d’interdire l’expulsion d’un étranger, si dangereux soit-il, s’il est exposé, dans son pays d’origine, à de mauvais traitements (Daoudi, 3 décembre 2009) ou s’il risque d’y faire l’objet de poursuites pénales non conformes aux canons européens du procès équitable (Othman Abu Qatada, 17 janvier 2012) ou si sa santé en souffrirait. Cette jurisprudence a imposé à la France de mettre en œuvre une législation permettant, non sans aléas, l’assignation à résidence hôtelière des intéressés.
- S’agissant de la crise pandémique, Agnès Buzyn et Edouard Philippe ne sont toujours pas sortis d’embarras puisqu’ils demeurent témoins assistés pour abstention volontaire de combattre un sinistre. Par ailleurs, si on peut espérer que la décision de la Cour de cassation du 20 janvier ait un impact sur les milliers de plaintes que la pandémie a fait affluer au tribunal judiciaire de Paris, il est douteux qu’elle suffise à contrecarrer cette tendance si française à pénaliser tous les accidents de la vie collective. Le désir du pénal n’est pas près de s’éteindre et la mise au pilori des dirigeants restera exigée du juge en cas de catastrophe publique …
Qu’on me comprenne bien. Je ne dis pas qu’il faut démanteler les contrôles juridictionnels sur les actes des pouvoirs publics.
Ce que j’essaie d’expliquer tient aux cinq constats suivants :
Premier constat : des prérogatives considérables ont été conférées aux différentes juridictions depuis une cinquantaine d’années (pouvoir d’injonction à l’égard des administrations, mise en cause pénale des responsables publics, pouvoirs de censurer et d’écarter la loi…) ;
Deuxième constat : ces pouvoirs considérables sont exercés par un corps distinct du Représentant, un corps qui applique des critères propres, qui ont leur validité, mais qui sont plus étroits que ceux que met en œuvre le Représentant lorsqu’il formule la volonté générale ; un corps qui a sa sociologie propre et sa propre vision du monde ;
Troisième constat : à la différence des autres pouvoirs, les juges ne sont responsables devant personne. Personne ne peut leur demander des comptes pour leur façon de juger ;
Quatrième constat : la combinaison des trois facteurs qui viennent d’être cités (extension des pouvoirs, autonomie sociologique et irresponsabilité) fait peser sur la démocratie un risque potentiel : celui que des politiques publiques, parfois cruciales, soient déterminées en dehors de la délibération démocratique et en méconnaissance des intérêts et de la sensibilité du corps social : soit que le juge se trompe, ce qui est humain ; soit qu’il poursuive des fins dans lesquelles le peuple, au nom duquel il juge, ne se retrouve pas ;
Cinquième constat : Il serait miraculeux que ce risque potentiel ne se réalise pas. De fait, il se réalise, comme le montrent les exemples donnés dans mon livre. Il se réalise sinon en permanence, du moins assez souvent pour concourir à la défiance de nos concitoyens à l’égard des institutions. Il se réalise de façon assez fréquente pour inhiber les responsables publics, qu’ils soient élus ou fonctionnaires. La peur de la censure ou de la condamnation peut alors l’emporter sur la recherche de la meilleure décision du point de vue de l’intérêt général.
De ce qui précède, qui tient encore une fois du constat et non du jugement de valeur, je tire l’idée qu’il faut, dans un pays comme la France, « recaler » le système institutionnel.
Le recaler pour restaurer tant la crédibilité du juge que le bon fonctionnement de la séparation des pouvoirs.
*
Il n’est pas question, pour moi, de jeter par-dessus bord la protection juridictionnelle des droits et libertés fondamentaux. Tout est question de mesure, de réglage de dosage.
Le nouveau réglage auquel je rêve tient, pour l’essentiel, au respect de deux principes.
Premier principe : le juge doit laisser une marge de manœuvre suffisante aux responsables publics, au niveaux national comme local. Il doit faire preuve de retenue face aux processus décisionnels démocratiques. Sauf erreur manifeste, il ne doit pas s’immiscer dans des appréciations d’opportunité.
Second principe : le contrôle juridictionnel ne devrait pas amplifier les tendances de l’ « air du temps » lorsque ces tendances jouent globalement contre l’intérêt général. Ainsi, le juge ne devrait pas contribuer aujourd’hui, par sa jurisprudence, à désarmer la société contre l’insécurité, l’islamisme, les atteintes à l’autorité de l’Etat ou la dérégulation des flux migratoires.
*
Donnons un exemple récent, parmi tant d'autres, de désarmement de la société par le juge.
Le 22 septembre 2022, le Conseil constitutionnel censure, comme insuffisamment encadré, l'article 60 du code des douanes, inchangé depuis 1948, selon lequel : « Pour l'application des dispositions du présent code et en vue de la recherche de la fraude, les agents des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises et des moyens de transport et à celle des personnes ».
Le Conseil exige des raisons plausibles de suspecter une fraude.
Mais comment cette exigence d’« extranéité » peut-elle encadrer concrètement l’action des douanes ?
Sur quels indices concrets nourrir des « raisons plausibles » de soupçonner un véhicule à un péage autoroutier : la marque du véhicule, son luxe, sa taille, sa vétusté, la fréquence des allers retours ?
La décision du Conseil constitutionnel condamne les contrôles aléatoires, qui sont pourtant stratégiques.
Exiger des « raisons plausibles » de soupçonner l’existence d’une infraction méconnaît la nature profonde du droit de visite des agents des douanes, lequel participe des prérogatives de « contrôle » et non pas d’« enquête ». Or, c’est le propre de la police administrative de pouvoir s’exercer même en l’absence d’indices préalables d’infraction, notamment pour mettre à jour de tels indices.
Si ces indices apparaissent, la police administrative « bascule » dans la police judiciaire et doit alors en effet apporter aux mis en cause des garanties de procédure. C’est du moins ce que j’avais appris, mais c’est ce que contredisait déjà la jurisprudence du Conseil constitutionnel des années 90 sur les vérifications d’identité …
L’article 60 du code des douanes était la pierre angulaire de l’action des agents des douanes. La direction des douanes s’arrache les cheveux pour savoir par quoi le remplacer.
En attendant sa réécriture, les défenseurs des trafiquants de drogues obtiennent relaxes et annulations de saisies, en arguant de l’inconstitutionnalité de l’article 60. Belle victoire pour l'Etat de droit !
*
Si l’audace juridictionnelle est, selon moi, admissible, c’est non pour relayer les emportements du temps, mais, à l’inverse, pour les tempérer.
J’en donnerai deux exemples.
Si audacieuse soit-elle, la jurisprudence de 2000 du Conseil constitutionnel sur la CSG (la progressivité fiscale ne peut jouer que sur l’ensemble des revenus du ménage) permet de faire barrage aux projets fous de l’extrême gauche en matière de redistribution, de fiscalité et de retraites.
Autre exemple, isolé, mais fondateur : si le raisonnement suivi par le Conseil d’Etat dans l’arrêt Canal, en 1962, est juridiquement osé lorsqu’il interdit à une habilitation référendaire en matière législative de déroger aux principes généraux de la procédure pénale, qui ne sont pourtant pas de niveau supra-législatif, il a cependant évité, au cours d’une période dramatique de notre histoire, un dérapage autoritaire marqué par la création d’une juridiction d’exception pouvant prononcer des peines capitales.
C’est ce que rappelait Emmanuel Piwnica il y a deux mois, au cours d’un échange amical mais ferme avec votre serviteur, devant le groupe des Professions Juridiques de Sciences- Po.
*
Ma position est donc la suivante : il faut faire en sorte que la politique et le droit ne se combattent plus mutuellement.
Que la politique agisse contre le droit est intolérable. Mais que le droit étouffe la politique n’est pas non plus acceptable.
Comment rendre sa marge de manœuvre au politique sans fouler aux pieds le contrôle juridictionnel ?
Des changements structurels sont concevables : je les évoque à la fin de mon livre.
Mais j’y dis aussi qu’ils sont très improbables. Ils prendraient à rebrousse-poil cinquante ans d’évolution des idées politico-juridiques en France comme en Europe et seraient rejetés par la majorité des forces politiques.
Il faut au moins inciter les juges à une plus grande retenue.
D’où ce livre qui n’est pas un pamphlet, mais qui n’hésite pas à forcer le trait pour susciter le débat
Le droit contre la loi
On m’objecte aussi qu’il est déroutant d’opposer, comme dans mon livre, le droit et la loi.
Il y a pourtant matière à le faire :
- Dans la conception classique de l’Etat de droit, la loi disait le droit, car elle exprimait la volonté générale ;
- Dans la conception contemporaine de l’Etat de droit, le droit se déconnecte de la loi (par les traités, la jurisprudence et la soft law) : il la surplombe, la supplante et, en tant que de besoin, la paralyse.
La genèse de cet assujettissement de la loi par le droit est récente et foudroyante.
Il fut un temps, pas si lointain (je l’ai connu en qualité d’auditeur lorsque je suis entré au Conseil d'Etat en 1979), où la loi trônait en majesté au sommet de l’édifice juridique :
- La loi fixait les règles ou les principes fondamentaux, selon les cas prévus à l’article 34 de la Constitution de 1958 ;
- Le décret en déterminait les modalités d’application ;
- Le juge interprétait la loi dans le strict respect de l’intention du législateur, telle qu’elle se dégageait des travaux parlementaires ;
- La loi postérieure au traité faisait écran à ce dernier (du moins aux yeux du juge administratif).
Tout cet édifice s’est retrouvé cul par-dessus tête au terme d’une évolution insidieuse, mais irrésistible, couvrant un demi-siècle.
Cette évolution conjugue divers phénomènes :
- La primauté du droit international et européen ;
- L’expansion des droits fondamentaux, bien au-delà de qu’on appelait pompeusement, dans les années 80, « la troisième génération des Droits de l’Homme » ;
- Des révisions constitutionnelles contraignant toujours plus les représentants de la Nation ;
- Et, bien sûr, la montée en puissance du pouvoir juridictionnel.
*
Cette évolution se propage dans et par le droit, mais elle trouve sa cause première en dehors du droit.
La déferlante des droits fondamentaux trouve en effet sa source dans les mentalités, à la confluence de divers phénomènes :
- Le « vagabondage d’idées chrétiennes devenues folles » (Gilbert Keith Chesterton) ;
- L’épanchement d’un Etat providence, assureur universel, devenu « Etat nounou » (Michel Schneider) ;
- L’individualisme exacerbé induit par les formes actuelles de la mondialisation et l’extension illimitée du domaine du marché ;
- Le délitement du sens de la transmission, de la civilité, de la solidarité, de la discipline, de l’autorité et (last but not least) de la Nation ;
- La political correctness communautariste importée des campus américains ;
- Enfin un gauchisme découvrant dans le droits-de-l’hommisme contentieux un substitut aux luttes révolutionnaires de naguère....
Le droit (textuel et jurisprudentiel) cautionne dans un second temps cette évolution.
Le droit devient en effet, pour les militants de la transformation radicale de la société, le champ de bataille principal, alors qu’il n’était, pour leurs prédécesseurs marxistes, qu’une superstructure bourgeoise dont il fallait dénoncer les faux-semblants.
Qui plus est, les revendications victimaires et catégorielles qui alimentent cette déferlante, médias et sensiblerie générale aidant, exaltent un droit des minorités, qu’elles soient ethniques, religieuses ou sexuelles.
Les droits individuels deviennent ainsi le cheval de Troie de revendications minoritaires.
Les phénomènes que j’évoque dans mon livre (primauté du droit européen, montée en puissance du juge, expansion des droits fondamentaux) sont liés et se renforcent mutuellement :
- Le rôle du juge, y compris du juge national, est crucial pour des institutions européennes qui se construisent et agissent exclusivement par le droit et ont besoin de trouver un « garde chiourme » dans le juge national ;
- La sauvegarde des droits individuels ne peut se passer de voies de recours juridictionnelles ;
- Les révisions constitutionnelles, depuis un demi-siècle, n’ont cessé, directement ou indirectement, d’accroître les pouvoirs du juge aux dépens des pouvoirs publics procédant de l’élection.
*
La loi promulguée n’est plus une valeur sûre.
En partie bien sûr en raison de défauts internes bien connus : bavardage, instabilité, hyperréactivité à l’actualité.
Mais pas seulement : sa dépréciation tient pour une large part à des causes extérieures.
La loi est en effet devenue un énoncé précaire et révocable, grevé de la double hypothèque du droit européen et (surtout avec la « question prioritaire de constitutionnalité ») du droit constitutionnel.
Elle n’exprime plus une volonté générale durable.
Elle n’est plus qu’une règle du jeu provisoire, perpétuellement discutable, continuellement à la merci d’une habileté contentieuse placée au service d’intérêts ou de passions privés.
L’article 3 de la Constitution de 1958, aux termes duquel « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum », a vu sa portée sérieusement amoindrie depuis un demi-siècle.
*
Cet amoindrissement se traduit dans l’ordre juridique international comme dans l’ordre juridique interne.
Dans l’ordre juridique international, la souveraineté nationale se rétracte.
Cette rétraction résulte d’abord des transferts de compétences au profit de l’Union européenne (y compris dans des domaines régaliens).
Plus généralement, elle résulte de la conclusion, dans tous les domaines, de traités qui produisent des effets juridiques non seulement entre Etats, mais également entre Etats et particuliers, voire entre personnes.
Des traités qui souvent nous lient à l’égard d’organes internationaux (y compris juridictionnels) chargés de veiller à la complète application du traité.
Dans l’ordre juridique interne, la souveraineté populaire est amoindrie par un droit toujours plus prégnant, qui déborde et contraint la loi, et dont la matrice se trouve ailleurs que dans la loi : plus particulièrement dans la jurisprudence des cours suprêmes, nationales et supranationales.
Souveraineté de l’Etat et souveraineté dans l’Etat : les deux ont été soumises depuis cinquante ans à une intense attrition.
Le modèle westphalien de la souveraineté nationale, comme le modèle démocratique de la souveraineté du peuple, ont été pareillement malmenés.
Au nom des droits de l’Homme, de la paix universelle et du doux commerce, Sieyès, comme Rousseau, sont relégués au magasin des pensées dépassées.
La subordination de la loi aux traités, aux actes de droit européen dérivé et aux décisions des cours nationales et supranationales conduit à l’impasse démocratique définie par Henri Guaino dans le Figaro du 27 octobre 2021 : vouloir faire la démocratie par le droit plutôt que le droit par la démocratie.
L’Etat de droit
Autre objection qui m’est faite : l’importance acquise par le juge dans les démocraties occidentales contemporaines n’est-elle pas la consécration de l’Etat de droit ?
Contester la puissance du juge n’est-ce pas s’élever contre l’Etat de droit ?
Je réponds à cette question par une autre : qu’entendez-vous exactement par Etat de droit ?
L’Etat de droit est devenu un mot valise, une notion polymorphe qui a une signification tantôt technique, tantôt idéologique, voire transcendantale.
Dans cette dernière acception, il devient une religion dont les droits fondamentaux sont les dieux et le juge le grand officiant.
*
Dans la tradition juridique française, l’expression « État de droit » renvoie non à un contenu programmatique, philosophique ou moral précis, mais à une architecture étatique.
Quelle architecture ?
Pour résumer les choses, disons que cette architecture étatique comprend trois composantes, qui me paraissent être les suivantes :
- La hiérarchie des normes (selon l’idée kelsénienne, reprise en France par Carré de Malberg) ;
- La souveraineté, dans sa double acception nationale (il n’est de pouvoir politique que dans la Nation) et populaire (le pouvoir politique procède du suffrage universel) ;
- Enfin, la séparation des pouvoirs, c’est-à-dire l’existence de trois pouvoirs spécialisés (législatif, exécutif et juridictionnel) interagissant pour se tempérer mutuellement, mais aussi pour coopérer, cette interaction étant encadrée, comme le veut l’article 16 de la Déclaration de 1789, par la Constitution.
Cette conception classique de l’Etat de droit présente deux traits constitutifs qui la distinguent fortement de la vision de l’Etat de droit que diffuse l’ « air du temps » :
- Tout d’abord, dans cette conception classique de l’Etat de droit, brossée par Montesquieu, les trois pouvoirs interagissent et se tempèrent mutuellement, mais aucun ne doit en mettre un autre sous sa coupe ;
- En second lieu, la liberté est inséparable de l’action positive (et non pas seulement de l’abstention) de l’Etat en faveur de la sûreté.
Examinons ces deux traits constitutifs d’un peu plus près.
Les pouvoirs publics interagissent et se tempèrent mutuellement, mais aucun pouvoir ne doit en mettre un autre sous sa coupe
Le pouvoir arrête le pouvoir dans les conditions fixées par la Constitution.
Ainsi, le Parlement peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement, le Chef de l’Etat dissoudre l’Assemblée nationale, le juge annuler un acte administratif ...
Mais ces interactions ne doivent conduire aucun des trois pouvoirs à méconnaître la spécificité des deux autres, ni à se substituer à eux, ni à tenter de les assujettir.
Ainsi, le Parlement ne doit pas adresser d’injonctions au pouvoir exécutif pour la conduite de la politique étrangère ; le juge ne doit pas s’immiscer dans le fonctionnement du Parlement ni se substituer à l’administrateur...
Et c’est là que le bât blesse :
- Les actes administratifs sont aujourd’hui sanctionnables par le juge dans des conditions beaucoup plus larges qu’il y a un demi-siècle. Ainsi, le juge administratif peut prononcer des injonctions.
- Quant aux lois, même anciennement promulguées, elles peuvent être abrogées par le juge constitutionnel depuis 2010 s’il en est saisi par un particulier (QPC), ou écartées par le juge ordinaire s’il les estime contraires aux traités (jurisprudences Vabre Nicolo).
Il n’est pas exagéré de dire qu’aujourd’hui le juge réglemente et légifère :
- Le juge administratif réglemente au travers des référés administratifs ou en assortissant ses annulations d’injonctions,
- Les juges judiciaire et administratif légifèrent en donnant aux lois la portée qu’ils estiment seule conforme au droit européen,
- et le Conseil constitutionnel légifère par la motivation dont il assortit les abrogations différées qu’il prononce en réponse à des QPC et - dans le contrôle a priori comme dans le contrôle a posteriori - par ses réserves d’interprétation. Ces motivations se présentent souvent en effet comme le programme à exécuter par le législateur, lorsqu’il tentera de réparer les pots cassés…
Second trait caractéristique de l’Etat de droit dans sa conception classique : la liberté est inséparable de l’action positive (et non pas seulement de l’abstention) de l’Etat en faveur de la sûreté de chacun
La sûreté est en effet la condition première de l’exercice des libertés, à commencer par les plus fondamentales d’entre elles (vivre, mener une vie privée et familiale, se déplacer, travailler, entreprendre, contracter, exprimer son opinion…).
Il en résulte que deux principes cardinaux sous-tendent l’action publique dans la conception classique de l’Etat de droit :
- Les pouvoirs publics sont soumis à la légalité ;
- Mais ils doivent assurer au peuple une protection effective.
Autrement dit : l’Etat doit non seulement respecter le droit, mais aussi le faire respecter.
Aussi la dialectique entre puissance publique et liberté est-elle vieille comme le contrat social.
La puissance publique menace-t-elle la liberté ? Bien sûr !
Il faut donc la contenir par divers garde-fous, comme la possibilité de recours juridictionnels.
Cependant, comme le montre le triste spectacle des sociétés sans Etat (ou dépourvues d’un Etat digne de ce nom), l’inexistence ou la carence de la puissance publique menace la liberté autant que son poids excessif. Cela commence avec les territoires que perd la République.
Il est vrai, historiquement, que les libertés ont été malmenées par le prince. Elles ne le sont pas moins dans l’espace (pensons à la Russie de Poutine et à la Turquie d’Erdogan).
Toutefois, pour Montesquieu déjà, la liberté se définissait comme « la tranquillité d’esprit du citoyen qui provient de son opinion que le gouvernement non seulement ne l’assujettit pas, mais fait en sorte qu’il ne puisse craindre d’un autre citoyen ».
L’Etat de droit doit rester le correctif de la souveraineté, non dévitaliser cette dernière.
On connaît la formule de Paul Valéry : « Si l'État est fort, il nous écrase. S'il est faible, nous périssons ».
Certes, au travers de la défense des droits fondamentaux, le juge agit en faveur des citoyens.
Toutefois, ni les textes, ni la jurisprudence ne doivent négliger les intérêts indivis de la collectivité, ce que les hommes de 1789 appelaient le Bien commun.
Gare à une vision des droits fondamentaux qui servirait l’individu abstrait, mais non la généralité des citoyens réels !
Gare à sacrifier la prise en compte des réalités et la recherche patiente du bien commun à ces grands mots et à ces principes désincarnés dont la politique et le droit contemporains ont fait des tabous.
Or c’est bien ce que nous faisons depuis un demi-siècle, car, en magnifiant des droits individuels, dont il a une vision de plus en plus absolue, le droit contemporain intègre de moins en moins le souci de l’intérêt général.
Cette vision est en outre myope. Faute de voir au-delà des droits individuels, elle méconnaît les besoins permanents et globaux de la population.
Se donnant comme finalité le respect intégral des droits (un droit ne se respecte pas à moitié), cette vision se désintéresse du réalisme et du coût social des mesures requises pour assurer ce respect intégral.
Ce dédain de la faisabilité et des problèmes d’allocation des ressources congédie l’éthique de la responsabilité.
Il est particulièrement générateur d’effets pervers et de frustrations lorsque le droit qu’il s’agit d’honorer est un droit-créance.
Or les « droits de » deviennent de plus en plus souvent des « droits à ».
Pensons au « droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé » inscrit à l’article 1er de l Charte de l’environnement, ou à la proposition de loi constitutionnelle, récemment adoptée en première lecture par une large majorité de députés, aux termes de laquelle « La loi garantit l'effectivité et l'égal accès au droit à l'interruption volontaire de grossesse. »
Faute de prendre en compte les effets globaux, différés, collatéraux, indirectement vertueux ou pervers, des politiques publiques - polarisée qu’elle est par l’incidence immédiate de ces politiques sur les droits individuels - la religion des droits individuels, ayant le juge pour grand prêtre, déprécie le Bien commun et néglige le long terme.
Ainsi, en matière répressive, les droits de la défense occupent tout son champ de vision. Obnubilée par la protection légale du fauteur de troubles et du prévenu, elle dessert leurs victimes actuelles et potentielles.
*
Entre droits individuels et intérêt général, la démocratie doit savoir arbitrer.
Le déplacement du curseur dans le sens de l’intérêt général est toutefois bloqué aujourd’hui par un absolutisme droit-de-l’hommiste, minoritaire dans l’opinion, mais influent dans le monde politique, médiatique, associatif et au sein même des institutions.
C’est cet absolutisme droit-de-l’hommiste et non l’État de droit qui est le problème.
Il nuit à l’État de droit qu’il prétend défendre, car, par ses excès, il conduit le citoyen à se demander si l’État de droit n’est pas devenu un carcan pour la démocratie, une mauvaise affaire pour les intérêts réels des «vraies gens» et, en fin de compte, pour nos libertés concrètes. «Des tas de droits », comme disait Guy Carcassonne, et j’ajouterais pour ma part : « des tas de droit tenant l’État à l’étroit».
En effet, dans la France contemporaine, les élites et les gens ordinaires se font une conception fort différente de l’expression « Etat de droit ».
Les unes et les autres n’en privilégient pas les mêmes aspects :
- Les élites accordent une importance majeure aux droits individuels et à la figure du juge ;
- Les gens ordinaires priorisent la sûreté et le suffrage universel.
Pour la majorité de nos compatriotes, l’Etat de droit est un état de la société dans lequel la puissance publique « fait en sorte que le citoyen n’ait pas à craindre des autres citoyens » pour reprendre les termes de Montesquieu.
Or la défense intransigeante des droits individuels face à la puissance publique, fondée notamment - s’agissant de la législation - sur un contrôle de proportionnalité pointilleux ou sur des moyens d’annulation comme l’« incompétence négative », conduit à brider les moyens de régulation, de prévention et de répression de l’Etat.
Elle conduit aussi à soumettre les pouvoirs procédant de l’élection à la tutelle d’instances non élues, qu’elles soient juridictionnelles ou para-juridictionnelles (autorités administratives indépendantes).
La doctrine applaudit au nom de la sauvegarde de l’« Etat de droit ». L’opinion, elle, ne se sent plus protégée.
Les beaux esprits se félicitent de voir le Léviathan enfermé dans sa cage. Les gens ordinaires s’inquiètent plutôt de ne plus le voir patrouiller dans la Cité.
Il s’agit là (parmi d’autres) d’un malentendu majeur entre les élites et le commun des mortels.
Pour la grande majorité de nos concitoyens, l’état de droit (« état » avec une minuscule) réside non dans le reflux de l’Etat gendarme, mais dans la capacité de celui-ci de faire respecter la loi et de protéger efficacement les citoyens contre les malfaisants et les fauteurs de troubles.
La montée en puissance du contrôle juridictionnel
Depuis quelques décennies, l’emprise du pouvoir juridictionnel, qui est polycéphale, s’est vertigineusement accrue sur les affaires publiques.
C’est une emprise diffuse, qui s’exerce à l’abri des regards et loin du citoyen.
Celui-ci n’en appréhende guère la réalité car, sauf exception, il n'est pas touché directement et personnellement par ses arrêts.
Les politiques eux-mêmes connaissent mal le pouvoir juridictionnel et ne le rencontrent le plus souvent qu’à leur corps défendant.
Le souci des convenances leur interdit de le critiquer ouvertement.
En privé, ils le maudissent fréquemment, mais, en public, protestent toujours de leur déférence pour lui.
Dans leurs programmes, ils trouvaient jusqu’ici commode de passer sous silence son emprise : le prétendant, surtout s’il promettait des réformes ambitieuses, n’allait pas crier sur tous les toits que le souverain était nu.
A cet égard, la campagne présidentielle pour 2022 a amorcé un changement de paradigme.
Pour la première fois en effet, au moins dans la bouche de certains candidats, s’exprime le désir du politique de s’émanciper de la tutelle du juge.
*
Comment se manifeste cette tutelle ?
D’abord par le fait que le contrôle juridictionnel s’est progressivement et considérablement amplifié, en surface comme en intensité.
Tout devient « justiciable » :
- A un bout, les « mesures d’ordre intérieur » (actes administratifs pris au sein des univers scolaires ou carcéraux, mesures de police etc),
- A l’autre bout, les lois.
Rien n’est plus soustrait au contrôle du juge.
Qui plus est, l’intensité du contrôle s’est accrue.
Nous sommes passés, en matière de conciliation entre libertés et intérêt général, de la vérification qu’il n’y avait pas d’« erreur manifeste d’appréciation » à un examen pointilleux de l’adaptation, de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure contestée.
Le contrôle de proportionnalité pousse le juge administratif à substituer son appréciation à celle du pouvoir réglementaire.
En témoigne l’ordonnance de référé du Conseil d’Etat du 22 juin 2021 sur l’assurance-chômage, à rapprocher de sa décision « Commune de Grande Synthe » du 1er juillet 2021 sur les émissions de gaz à effet de serre.
Dans la première affaire, il enjoint au gouvernement de ralentir la mise à exécution d’une mesure. Dans la seconde – l’ « affaire du siècle » - il lui ordonne de hâter le pas. Dans les deux cas, le juge détermine le rythme des réformes.
Le Conseil constitutionnel agit depuis longtemps de même avec le législateur.
Parmi de multiples exemples, on mentionnera l’affaire de la garde à vue, il y a une dizaine d’années.
Plus récemment, mais on a l’embarras du choix, citons la censure du passage de douze à vingt-quatre mois de la durée des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance applicables, à la fin de leur peine, aux personnes ayant été condamnées à une peine privative de liberté pour des faits de terrorisme (30 juillet 2021).
Ajoutons que le juge administratif a été doté d’un pouvoir d’injonction qu’il ne possédait pas il y a une quarantaine d’années (référé liberté ou commandement assortissant une annulation, comme dans l’« affaire du siècle »).
Soulignons aussi que les principes applicables (constitutionnels et conventionnels), de caractère très général, offrent une prise propice à la subjectivité du juge.
Par exemple le droit à la vie privée et familiale (article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales) a donné lieu à une jurisprudence très constructive de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) et de nos cours nationales en matière de regroupement familial des étrangers résidant en France, en matière sociétale et en matière de protection des données personnelles.
C’est également au nom du respect de la vie privée et familiale que le Tribunal administratif de Paris annule l’expulsion de M Iquioussen, en jugeant que l’atteinte que son expulsion causerait à sa vie privée et familiale serait plus grave que la menace que font peser sur l’ordre public les discours de l’intéressé incitant à la haine et à la discrimination.
Le juge ordinaire, même de première instance, dispose du considérable pouvoir d’écarter une disposition législative qu’il estime contraire aux engagements internationaux ou européens de la France, même lorsque cette disposition est postérieure à la ratification du traité.
Je renvoie aux arrêts J Vabre de 1975 de la Cour de cassation et Nicolo de 1989 du Conseil d’Etat (ce dernier après 14 ans de résistance). Ces deux arrêts ont été induits – ne l’oublions pas - par la décision du Conseil constitutionnel du 15 janvier 1975 sur l’IVG.
C’est ainsi (pour ne citer que cet exemple) que la Cour de cassation, sur le fondement de l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, fait une interprétation réductrice de la loi El Khomri dans les affaires de port du voile en entreprise : elle ne concernerait que le personnel en contact avec le public (Cass. Soc, 22 novembre 2017).
Cette extension du domaine et de l’intensité du contrôle juridictionnel est, je l’ai dit plus haut, l’œuvre :
- tantôt du constituant (institution de la « question prioritaire de constitutionnalité » en 2008, autorisation de ratifier les traités européens),
- tantôt du législateur (référé libertés),
- tantôt du juge lui-même.
*
Un autre facteur important de cette montée en puissance du pouvoir juridictionnel est ce qu’on appelle benoîtement le « dialogue des juges », c’est-à-dire le mimétisme, l’émulation, pour ne pas dire la surenchère, entre cours suprêmes. Nous en avons cinq en France
*
Ajoutons encore que le prétoire s’est ouvert, au cours du demi-siècle écoulé, à des requérants toujours plus nombreux.
L’Intérêt pour agir est de plus en plus libéralement apprécié par le juge administratif et par le juge pénal.
C’est ainsi que les plaintes de l’association « Anticor » et de syndicats de magistrats sont jugées recevables devant la Cour de justice de la République dans l’affaire Dupont Moretti.
Devant les juridictions répressives, la liste des catégories d’associations pouvant se porter partie civile ne cesse de s’allonger dans le code de procédure pénale.
On s’est bien éloigné du principe : « nul ne plaide par procureur ».
Last but not least : depuis une dizaine d’années, toute personne à laquelle une loi est appliquée peut contester, en présentant une « question prioritaire de constitutionnalité », le respect par cette loi des droits et libertés constitutionnellement garantis.
*
Le pouvoir d’interprétation du juge, à force d’ajouter et de retrancher à la loi au nom de principes supra-législatifs, se mue en pouvoir normatif autonome.
Le juge national ajoute à la loi, voire à la Constitution, comme lorsque le Conseil constitutionnel découvre de nouveaux principes constitutionnels de portée contraignante. C’est ainsi que le CC fait dériver du principe de fraternité, figurant dans la devise de la République, l’impossibilité de pénaliser l’aide à la circulation des étrangers en situation irrégulière, si cette aide est désintéressée.
Les cours suprêmes européennes font de même avec les traités.
En matière de conciliation entre libertés et intérêt général, nous sommes passés, je l’ai dit, de la simple vérification qu’il n’y avait pas d’«erreur manifeste d’appréciation» à un examen pointilleux de l’adéquation, de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure contestée.
*
Le contrôle de proportionnalité, comme celui dit de l’« incompétence négative » interdisent désormais au législateur et au pouvoir réglementaire de prendre ces mesures simples, souples, générales et lisibles qu’ils prenaient auparavant, et qui permettaient l’adaptation aux réalités du terrain par l’administration, sans interdire un contrôle raisonnable du juge.
Qu’elles soient réglementaires ou législatives, les mesures simples à énoncer et à appliquer sont aujourd’hui censurées pour leur défaut d’encadrement, autrement dit parce qu’elles ne préviennent pas de façon assez détaillée d’éventuels dérapages liberticides.
*
Cette évolution a été consentie par le politique.
Elle a été saluée par les commentateurs de la chose publique comme une conquête de la démocratie, comme une garantie contre l’arbitraire et comme une apothéose de l’Etat de droit.
On n’a oublié que deux choses :
- Le juge n’est ni omniscient, ni infaillible ; lui aussi est habité par des préjugés ;
- De plus, contrairement à une fonction publique qui répond devant l’autorité ministérielle, à un gouvernement qui répond devant le Parlement et à un Parlement qui répond devant le peuple, le juge est inamovible et ne répond devant personne, pas même devant sa hiérarchie, de sa manière de juger. Celle-ci, fût-elle grossièrement partiale, fût-elle aberrante, ne relève d’aucun recours disciplinaire, pas même devant le Conseil supérieur de la magistrature…
Bien peu, dans la classe politique ou parmi les observateurs de la chose publique, ont pressenti quel impérium juridictionnel portaient en germe les prérogatives acquises par les juges au cours des cinquante dernières années…
Quis custodiet ipsos custodies ? Qui gardera les gardes ?
La question posée par Juvénal, au deuxième siècle de notre ère, demeure sans réponse, nonobstant l’exigence formulée par l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration. »
Le rôle du juge judiciaire dans la judiciarisation de la vie publique
Et le juge judiciaire dans tout cela ?
Dans une partie de la magistrature judiciaire, partie non majoritaire sans doute, mais significative, la volonté de camper un contre-pouvoir purificateur, voire d’exercer un pouvoir au-dessus des autres pouvoirs, se nourrit d’un ressentiment contre le système politique et contre l’appareil d’Etat.
La magistrature présente sociologiquement, politiquement et culturellement une grande homogénéité.
Elle a, pour une notable partie de ses membres, sa vision propre de la société et de la fonction qu’elle estime devoir y exercer. C’est une fonction rédemptrice.
Lorsqu’elle s’acharne contre des responsables politiques, c’est de son propre chef et non, comme certains s’obstinent à le croire ou à le laisser croire, pour complaire à d’autres responsables politiques.
Recrutés très jeunes par la voie de l’Ecole nationale de la magistrature, sans expérience ni de la société, ni de l’Etat, ni d’ailleurs de la vie, les magistrats trempent pendant toute leur scolarité dans une bien-pensance rédemptrice.
Leur carrière se déroule le plus souvent tout entière dans la magistrature.
Ils ne sortent guère d’un entre-soi qui est à la fois professionnel, idéologique et, souvent, endogamique.
Pour comprendre cette forme de repli collectif sur soi, il faut aussi tenir compte de la pugnacité des syndicats de magistrats.
Les deux principaux d’entre eux, seuls représentés au sein du Conseil supérieur de la magistrature, sont des groupes de pression politiques qui interviennent bruyamment dans les débats publics, loin de tout devoir de réserve.
C’est à la suite de recours syndicaux que l’actuel garde des sceaux a été mis en examen devant la Cour de justice de la république.
Tous les juges ne sont évidemment pas des Torquemada, mais une pulsion purificatrice parcourt les Palais de justice.
L’autorité judiciaire attrait souvent dans le champ pénal des manquements moraux des présumés « puissants » de ce monde, qui ne sont pourtant pas constitutifs d’infractions.
Elle use, à cet effet, de diverses méthodes.
La première est d’interpréter de façon large les dispositions définissant les délits et les crimes.
- Ainsi, dans les affaires d’assistants parlementaires, les termes de l’article 432-15 du code pénal, relatif au détournement de fonds publics, sont interprétés extensivement, alors que les dispositions d’incrimination sont de droit strict.
- Il en est de même, dans le cadre de la crise sanitaire, de ceux des articles 223-1, relatif à la mise en danger de la vie d’autrui, et 223-7 relatif à l’« abstention volontaire de combattre un sinistre ».
Le juge pénal peut également « surqualifier » les faits. C’est ainsi que la qualification d’« escroquerie en bande organisée » a été retenue dans l’affaire de l’arbitrage Tapie.
Une autre méthode consiste à faire une interprétation minimaliste des dispositions instituant des immunités ou des irresponsabilités en faveur des membres des pouvoirs exécutif ou législatif et, plus généralement, de traiter cavalièrement les questions de compétence judiciaire et de séparation des pouvoirs.
Ainsi, le 29 mars 2021, dans l’affaire du Médiator, le tribunal correctionnel de Paris juge que les activités de parlementaires au sein d’une mission d’information parlementaire ne sont couvertes par aucune immunité. Pour parvenir à cette conclusion, le tribunal opère une distinction entre « commission d’enquête » et « mission d’information » totalement artificielle au regard des dispositions du premier alinéa de l’article 26 de la Constitution qui prévoient, de façon générale et claire, qu’« aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions ».
Enfin, l’autorité judiciaire peut faire un usage tourmenteur des moyens d’enquête et d’instruction, alors même qu’aucune condamnation ne sera prononcée in fine.
L’emploi excessif des mesures d’enquête et d’instruction paraît manifeste dans la mise sous écoutes téléphoniques pendant des mois de Nicolas Sarkozy et de son avocat.
De même, les perquisitions ou mises en examen à grand spectacle stigmatisent des personnalités avant tout jugement.
L’activisme judiciaire ne se limite pas au domaine pénal.
En matière de droit du travail, la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation s’est montrée si constructive qu’elle est plus redoutée par les employeurs que les revendications syndicales.
Elle n’a pas peu contribué à grossir le code du travail français dans des proportions inconnues à l’étranger, soit que le législateur, par souci de sécurité juridique, codifie les avancées de la jurisprudence (par exemple pour la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrats à durée indéterminée), soit qu’il cherche à préciser les textes pour limiter les effets les plus déstabilisateurs de la jurisprudence.
Ont leur part, dans cet activisme judiciaire :
- Les préjugés hostiles au monde politico-administratif,
- Les passions tristes (comme celles qui s’affichent sur le « Mur des cons »),
- Une vision parfois manichéenne de la société,
- La tentation du vedettariat,
- L’idée que le juge ne saurait se borner à être un « tiers impartial » et que, bien au contraire, sa mission est de contribuer à transformer la société.
On peut aussi y voir l’expression d’une revanche sociologique contre les conditions (en effet déplorables) d’exercice de la justice et contre une perte de statut dont les magistrats rendent responsable le « système » dans son ensemble.
Cette rancœur rejoint d’ailleurs l’amertume de toute une catégorie de travailleurs intellectuels (enseignants, journalistes etc) qui s’estiment insuffisamment valorisés par la société.
On peut y voir enfin l’endossement par le juge du rôle purificateur qu’une partie de l’opinion, échauffée par les militants, les médias et les réseaux sociaux, veut lui voir jouer.
La traque judiciaire des responsables publics forme un cercle vicieux avec l’obsession de vertu qui s’est emparée de nos us et coutumes politiques au cours des années récentes.
La France a importé à cet égard, comme l’explique Régis Debray, le modèle puritain de l’Europe protestante.
L’aspiration à la probité absolue, comme tous les intégrismes, conduit à la chasse aux sorcières.
La quête de la perfection, lois de moralisation et lanceurs d’alerte à l’appui, instaure une veille permanente et distille partout le soupçon.
Impliquant la traque du pécheur, la prétention de faire régner le Bien sur terre entretient, comme un prurit, le besoin de débusquer le Mal. Une liturgie sacrificielle est à l’œuvre.
La diabolisation de l’action des pouvoirs publics s’est manifestée à l’envi au cours de la crise sanitaire.
Pour une bonne part, les recours introduits au sujet du Covid-19, le plus souvent portés par des associations et syndicats radicaux, visent à punir les responsables politiques, administratifs et économiques pour ne pas avoir su anticiper et neutraliser le fléau.
Pour le reste, les recours fustigent la pulsion « liberticide » qui serait celle d’un mauvais pouvoir, désireux de mettre la population au pas, sous prétexte de lutter contre un virus.
Laxisme et dictature sanitaire sont tour à tour dénoncés dans les requêtes et parfois par les mêmes.
Le phénomène de pénalisation de la vie publique, ce « désir du pénal » déjà si fort en période normale, tourne, en période de crise, à la traque moyenâgeuse du bouc émissaire.
Le juge est par ailleurs sommé d’imposer la politique idéale à un pouvoir indifférent aux malheurs des gens.
Le juge cède parfois à ces objurgations, tel le tribunal administratif de Basse-Terre ordonnant à l’administration, en mars 2020, de "passer commande des doses nécessaires au traitement de l'épidémie de Covid-19 par l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, comme défini par l'IHU Méditerranée infection, pour 20 000 patients".
Ainsi encore, en ouvrant les vannes de la recevabilité des plaintes, puis en perquisitionnant le domicile et le ministère d’Olivier Véran, puis en mettant en examen Agnès Buzyn et en plaçant sous statut de témoin assisté Edouard Philippe, les organes compétents de la Cour de justice de la République (Commission des requêtes et Commission d’instruction) laissent la Cour se faire instrumentaliser par la vindicte qui a saisi une partie de la société à l’égard des acteurs publics.
Or les erreurs de prévision et de gestion commises avant et pendant cette crise, comme lors d’autres crises (amiante, sang contaminé…) sont diluées, collectives et non intentionnelles.
Les dysfonctionnements sont blâmables, mais ils sont le fruit de défaillances diverses, anciennes, entremêlées. Ils résultent d’une interaction de causes dont personne n’a vraiment eu ni la maîtrise, ni même la connaissance.
Ces défaillances relèvent d’autres types de responsabilités (politique, administrative, disciplinaire, pécuniaire) que la responsabilité pénale. Elles appellent des réformes, non des procès.
La pénalisation excessive de la vie publique fausse l’action publique dans un sens défavorable à l’intérêt général car, selon les contextes, elle pousse nos décideurs soit à se défausser (par dilution des responsabilités), soit à sur-réagir (par précaution)
Droits individuels et bien commun
L’essor des droits individuels depuis quelques décennies présente évidemment un aspect positif. Loin de moi l’idée de soutenir le contraire.
Mais il y a un passif au bilan. Les juges et les cours internationales et européennes, en promouvant ces droits, font parfois prévaloir les intérêts de chacun au détriment de tous, ou les intérêts des minorités au détriment du commun…
Ainsi que l’expose Bertrand Mathieu : « Une erreur courante consiste à considérer que démocratie et droits de l’Homme forment un tout indissociable. Les droits fondamentaux sont simplement les valeurs sur lesquelles les démocraties libérales ont décidé de s’appuyer. Poussés à l’extrême, ils mènent nécessairement à l’éclatement de la notion d’intérêt général…».
Tout en mettant un point d’honneur à respecter les droits et libertés individuels, notre système juridique ne devrait ni les laisser confisquer par les groupes de pression, ni tout leur sacrifier, notamment pas la solidarité et la cohésion sociales.
Pensons aux vaccinations obligatoires, aux sujétions de la défense nationale (et demain, peut-être, du service national), aux servitudes d’urbanisme, à la sécurité routière, à l’ordre public économique et social, aux multiples sacrifices que supposerait une politique écologique ambitieuse pour nos libertés personnelles. Il faut bien contruire les centres de traitement d’ordures ménagères, les établissements pénitentiaires et les hôpitaux psychiatriques quelque part (in someone’s backyard). Paralysera-t-on demain le don d’organes, l’enseignement de la médecine et la recherche médicale, parce que, au nom de la liberté religieuse ou d’une conception subjective de la dignité de la personne humaine, on aura subordonné au consentement explicite et solennel de l’intéressé, donné de son vivant, l’utilisation de son corps après sa mort ?
L’engouement pour les droits fondamentaux, pavé des meilleures intentions humanistes, risque d’évincer l’intérêt général, les valeurs collectives et les devoirs de chacun au profit de doléances individuelles et catégorielles.
Il produit une société contentieuse où chacun est en guerre contre tous. Il fait naître des créances dont seul le juge, national ou supranational, fixera effectivement la portée.
Dans bien des cas, le souci des droits de chacun fait oublier au juge (et souvent aussi au législateur) l’intérêt de tous.
Premier exemple : l’affaire des décrocheurs de Lyon. En septembre 2019 le tribunal correctionnel de Lyon relaxe deux personnes qui, s’étant emparées de la photo officielle d’Emmanuel Macron dans la mairie du IIe arrondissement de la ville, en compagnie d’une vingtaine d’autres activistes ayant fait irruption dans les locaux, étaient poursuivies pour vol en réunion. Pour le tribunal correctionnel, l’enlèvement du portrait du chef de l’État ne saurait être pénalement sanctionné, parce que ses auteurs, militants écologistes, se trouvaient dans un « état de nécessité » face à l' « inaction de l'État contre le réchauffement climatique ». L’enlèvement du portrait du Président doit être regardé, selon le tribunal, « comme le substitut nécessaire du dialogue impraticable entre le président de la République et le peuple ». Le tribunal ne se borne pas à trouver aux décrocheurs des circonstances atténuantes. Il présente le décrochage comme la réponse légitime à la carence des pouvoirs publics face à un fléau planétaire. Mieux : Il fournit une théorie générale de la nécessité de la désobéissance civile face à un pouvoir indigne : « Le mode d’expression des citoyens en pays démocratique », considère-t-il en effet, « ne peut se réduire aux suffrages exprimés lors des échéances électorales, mais doit inventer d’autres formes de participation dans le cadre d’un devoir de vigilance critique ». Il n’est guère surprenant que ce jugement ait été applaudi par le monde militant ("Le juge a été très courageux, cette décision restera dans l'histoire", a déclaré Cécile Duflot).
Deuxième exemple : le meurtre du père Olivier Maire. En vertu d’une combinaison de jurisprudences protectrices, le contrôle judiciaire de l’incendiaire de la cathédrale de Nantes fait obstacle à son éloignement après sa détention provisoire et ses troubles psychiatriques s’opposent à son expulsion vers le Rwanda, non équipé pour le soigner (sans l’empêcher de quitter l’hôpital psychiatrique dix jours avant l’irréparable). A la veille du meurtre, Il n’est donc ni incarcéré, ni interné, ni éloigné. D’une certaine façon, la vie d’un homme admirable est sacrifiée sur l’autel du respect des droits individuels de son assassin.
Troisième exemple : la sévérité avec laquelle les textes et la jurisprudence regardent l’emploi de leurs armes par les forces de l’ordre.
Il ne paraît pas choquant à nos concitoyens qu’un policier tire contre un véhicule qui, roulant à contre-sens, force un barrage de police et fonce sur un agent, comme sur le Pont-Neuf le 24 avril 2022. Dans cette affaire, le jeune policier qui a fait feu n’en est pas moins gardé à vue 48 heures « eu égard à la gravité des conséquences de son acte » (deux trafiquants de drogue tués et un autre blessé) et mis en examen, sans attendre les conclusions de l’enquête de l’inspection générale de la police nationale (IGPN). La juridiction d’instruction qualifie les faits d’« homicide volontaire » sur la personne du conducteur.
Les circonstances paraissent pourtant relever de l’article L 435-1 du code de la sécurité intérieure (l’usage de leurs armes de service est possible aux agents de l’ordre « en cas d'absolue nécessité », « de manière strictement proportionnée », notamment « 4° Lorsqu'ils ne peuvent immobiliser, autrement que par l'usage des armes, des véhicules (…) dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt et dont les occupants sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d'autrui »).
L’Etat de droit mettrait-il un point d’honneur à juger plus sévèrement les titulaires de l’autorité que les ennemis de la société ? Nécessaire exemplarité des forces de l’ordre ? Certes, mais une chose est d’astreindre policiers et gendarmes au sang-froid et au discernement, autre chose d’exiger d’eux l’impossible : appréhender, sans jamais coup férir, les auteurs d’infraction. Si, même lorsque l’emploi d’une arme de service se situe dans un cadre légal et s’apparente de près à une légitime défense, les policiers font l’objet de gardes à vue, d’enquêtes pénales et de qualifications aussi graves que celle d’homicide volontaire, ne devraient-ils pas toujours s’abstenir de faire usage de leurs armes ?
Et comment ne pas rapprocher cette affaire de celle de Philippe Monguillot (ce chauffeur de bus de Bayonne tabassé à mort en juillet 2020 par une bande de voyous) dans laquelle la juge d'instruction, contredisant le parquet de Bayonne (qui avait qualifié les faits d’homicide volontaire aggravé), les a requalifiés de «violences volontaires en réunion ayant entraîné la mort sans intention de la donner», faisant ainsi échapper les auteurs des faits à la Cour d’assises ? Comment ne pas être troublé de voir les juges d’instruction retenir l’homicide volontaire à l’encontre du policier du Pont-Neuf et l’écarter s’agissant des meurtriers du chauffeur de bus de Bayonne ?
Le souci de se doter de garde-fous contre d’éventuelles bavures policières est légitime, mais, poussé à un degré excessif, dans les textes comme dans la pratique judiciaire, il prend le pas sur la protection de la société. En effet, même lorsqu’il respecte scrupuleusement les règles d’intervention, même lorsqu’il s’entoure de toutes les précautions d’usage, l’emploi de la force légale comporte des risques incompressibles d’atteinte à l’intégrité physique.
Et pas seulement avec les armes à feu. Charger un attroupement illicite qui, malgré les sommations, refuse de se disperser, comporte le risque de blesser des manifestants. De tels risques doivent être limités, en raison de leurs conséquences graves, parfois dramatiques, mais ils ne peuvent être éliminés. Imposer que « cela n’arrive jamais », reviendrait à interdire à l’Etat d’avoir recours à la force légitime. Ce serait fixer comme consigne aux policiers et aux gendarmes de ne jamais tirer, de ne jamais charger. Mais ce serait ainsi débrider la violence illégitime des casseurs et des voyous, assurés qu’ils seraient de la passivité des agents de l’ordre public. Le sentiment d’impunité qui en résulterait du côté des malfrats achèverait de démotiver les gardiens de l’ordre et renforcerait l’audace des auteurs d’infractions, entraînant une hausse de la délinquance et une atteinte irréversible à l’autorité de l’Etat.
A une époque où la surenchère victimaire envahit les relations sociales, les victimes de la délinquance et des incivilités sont, pour leur part, invisibilisées par le « fait divers ». Et la victime n’est plus tout-à-fait une victime lorsqu’elle est titulaire de fonctions officielles, lorsque, pour son malheur, elle incarne l’autorité. Les agressions contre les élus locaux ont fait un bond depuis une vingtaine d’années. Les refus d’obtempérer aux injonctions des agents de la force publique ont pareillement explosé. La réponse répressive est sévère pour les titulaires de fonctions officielles, compréhensive pour leurs agresseurs. Est-ce bien ce qu’on attend de l’Etat de droit ?
Dernier exemple : un professeur participe à l’évacuation musclée d’un amphithéâtre occupé par les étudiants en mars 2018 à la Faculté de droit de Montpellier. Il s’est joint à l’action en distribuant quelques taloches (ce qui est évidemment critiquable), mais il n’est ni masqué, ni armé et il n’est pas à l’origine de l’intervention. Le CNESER lui inflige l’interdiction de quatre ans d’exercice, ce qui est déjà sévère. Le Conseil d’Etat, en cassation, estime cette peine hors de proportion car… trop douce. Seules les deux peines les plus hautes (mise à la retraite d’office et révocation) convenaient, selon lui, aux agissements incriminés que l’arrêt (du 30 décembre 2022) ne cherche aucunement à contextualiser. Faut-il comprendre qu’une opération du type de celle à laquelle a participé ce professeur contre un « mouvement national », si virulent soit-il, est une faute disciplinaire capitale méritant, même en l’absence de dommages corporels, même dans le but de restituer un amphithéâtre à sa vocation naturelle, la sanction la plus élevée dans l’échelle des peines disciplinaires ? Fermer définitivement les portes de l’université à un professeur (dont les mérites académiques ne sont pas en cause) parce qu’il a répondu par la force à l’agression de locaux universitaires revient à dire que la défense irrégulière des locaux est plus condamnable que leur occupation irrégulière.
Comment ne pas rapprocher cette attitude de la sévérité observée par le juge judiciaire en matière de légitime défense, de réaction des agents de l’ordre aux refus d’obtempérer et de récupération, par leurs propriétaires, de logis squattés ? On en arrive ainsi à cette idée que, dans beaucoup de cervelles de juges, La violence de l’agressé porte plus atteinte à l’Etat de droit que celle de l’agresseur.
Dans ces affaires de refus d’obtempérer, comme dans le cas des « décrocheurs » des portraits du Chef de l’Etat dans les mairies (la relaxe des décrocheurs vient d’être confirmée en appel), l’autorité judiciaire semble se retourner contre l’ordre public et suivre les consignes figurant dans la célèbre harangue qu’Oswald Baudot, substitut à Marseille et membre du Syndicat de la magistrature, adresse en août 1974 à ses collègues débutants : « Soyez partiaux. Pour maintenir la balance entre le fort et le faible, le riche et le pauvre, qui ne pèsent pas d’un même poids, il faut que vous la fassiez un peu pencher d’un côté… Dans vos fonctions, ne faites pas un cas exagéré de la loi et méprisez généralement les coutumes, les circulaires, les décrets et la jurisprudence. Il vous appartient d’être plus sage que la Cour de cassation, si l'occasion s’en présente ».
Que faire ?
Les pouvoirs publics issus de l’élection sont aujourd’hui entravés et tourmentés par le pouvoir juridictionnel, national et supranational, comme Gulliver par les Lilliputiens.
Comment faire revenir le pouvoir juridictionnel à sa juste place (réguler, sans les inhiber, les fonctions régaliennes) ?
L’idéal serait que le pouvoir juridictionnel se convertisse spontanément à ce que les juristes anglo-saxons appellent le « self restraint ».
Rien d’autre ne serait alors à modifier dans notre ordonnancement institutionnel et juridique….
Mais c’est une vue de l’esprit : les prétoires sont trop nombreux, l’entraînement mimétique trop grand, les pressions sur le juge trop fortes, les jurisprudences trop cristallisées.
Il faut donc libérer Gulliver des liens qui l’étouffent. Comment ?
S’agissant de la jurisprudence européenne, commençons par appliquer plus sérieusement qu’aujourd’hui le contrôle de subsidiarité. Cela appartient au Parlement.
S’agissant de la pénalisation de la vie publique, il faut au moins ne pas aggraver la situation et mettre fin au masochisme législatif pour l’avenir.
Comment ? Notamment en renonçant à faire de la loi pénale la sanction d’une impossible obligation de résultat pesant sur les acteurs publics.
Et, à rebours du projet constitutionnel lancé sous le précédent quinquennat, en s’abstenant de mettre au droit commun la responsabilité pénale des ministres.
A terme, il est nécessaire d’alléger le risque répressif pesant actuellement sur les responsables publics en simplifiant ou en clarifiant les obligations pénalement sanctionnées, en définissant de façon moins floue les infractions et en ouvrant, auprès des hautes autorités de déontologie et de transparence créées au fil des ans, des possibilités de « rescrit » excluant les poursuites.
Cette campagne de « dépénalisation » s’inscrirait dans le sillage de la loi « Fauchon » du 13 mai 1996 et de la loi du 10 juillet 2000 « tendant à préciser la définition des délits non intentionnels » qui ont défini de façon plus restrictive les délits non intentionnels mentionnés à l’article 121-3 du Code pénal, contrecarrant ainsi le flot de mises en cause et de condamnations ayant touché les élus locaux au titre de l’imprudence ou de la négligence.
Sortons du masochisme législatif comme du sadisme juridictionnel.
C’est principalement au peuple souverain que les responsables publics doivent rendre compte. Les élections sont faites pour cela.
Pour ce qui est de l’attitude du juge judiciaire, c’est l’isolement socio-culturel de la magistrature, et plus particulièrement la coupure entre la magistrature judiciaire et le reste de l’Etat, qu’il faut réduire.
On peut agir sur l’état d’esprit des magistrats tant au niveau de la formation initiale (en y donnant une place plus grande au souci de l’intérêt général, en faisant découvrir aux élèves magistrats les réalités de la société et de l’Etat…) que de l’ouverture de la magistrature à l’extérieur (tours extérieurs, mobilités dans l’administration et la société civile).
La magistrature doit s’ouvrir aux expériences extérieures en recrutant hors ENM dans une proportion sensiblement supérieure à l’actuelle.
Quant aux magistrats issus de l’ENM, ils doivent sortir de leur tour d’ivoire en accomplissant des périodes de mobilité au sein de l’administration et de la société civile.
S’agissant du contrôle de constitutionnalité, il conviendrait a minima que les parlementaires (groupes, commissions, rapporteurs…) puissent défendre une loi devant le Conseil constitutionnel. Il n’est pas normal que l’exclusivité de la défense de la loi revienne au Secrétariat général du Gouvernement.
Si scrupuleux et compétent soit-il, ce service du Premier ministre est en porte-à-faux lorsqu’il s’agit par exemple de défendre une disposition issue d’un amendement que le Gouvernement a combattu en séance.
Rien de cela n’implique une modification de la Constitution ou des traités. Mais je doute que cela soit suffisant à long terme pour restaurer un fonctionnement plus sain de la séparation des pouvoirs.
Que faire alors de plus pour faire rentrer le pouvoir juridictionnel dans son lit, sans évidemment l’abolir ?
Pour répondre sincèrement à cette interrogation, j’ai dressé dans mon livre « La démocratie au péril des prétoires » un catalogue de solutions que certains qualifieront de remèdes de cheval :
- Instaurer une procédure de « dernier mot parlementaire » pour confirmer une loi censurée ;
- Dénoncer la Convention européenne des droits de l’homme ;
- Permettre à un CSM rénové de connaître des atteintes au devoir d’impartialité ;
- Séparer le siège du parquet et donner au garde des sceaux les moyens de mener une véritable politique pénale (dont il puisse répondre devant le Parlement) en plaçant le ministère public sous son autorité et en redonnant au ministre de la justice la possibilité de donner au procureur des instructions écrites (versées au dossier) dans les affaires particulières …
Ce changement de paradigme prendrait à rebrousse-poil cinquante ans d’évolution des idées politico-juridiques en France comme en Europe. Il serait dénoncé comme une régression autoritaire et liberticide par la majorité des forces politiques. La Pologne et la Hongrie ont été stigmatisées par l’Union européenne pour moins que cela.
Pour autant, ces changements constitutionnels et conventionnels mettraient en place un cadre juridique proche de ce qu’il était en France il y a un demi-siècle.
Dira-t-on que la République que présidaient Georges Pompidou et Valéry Giscard d’Estaing n’était pas un Etat de droit ?
Post scriptum : quel statut pour le parquet ?
En apparence tout est simple : notre droit consacre le principe de l’unité de la magistrature judiciaire. Ceux qui jugent (le siège), comme ceux qui poursuivent (le parquet), sont pareillement des magistrats. Au-delà de la différence de leurs fonctions, ils appartiennent au même corps, sont (dans leur majorité) issus de même école, prêtent le même serment et peuvent passer d’une fonction à l’autre au cours de leur carrière.
A y regarder de plus près, l’unité du corps judiciaire est loin d’aller de soi.
Si, en démocratie, l’indépendance du juge du siège est consubstantielle à l’acte de juger, il en va différemment de la fonction de poursuivre. Par sa mission, le parquet a vocation à entretenir des liens avec l’État dont il est l’instrument. Devant les juridictions, il représente la société, défend les intérêts de la collectivité et veille à l’application de la loi. Sa qualification de « ministère public » traduit cette réalité.
Le magistrat du parquet est chargé non de juger, mais d’enquêter et de requérir conformément à la politique pénale gouvernementale. Cette mission de défense de l’intérêt général prolonge, sur le plan pénal, celle dont l’État a plus généralement la charge.
Il est donc naturel que les magistrats du parquet soient placés, sur le plan fonctionnel, sous l’autorité du garde des sceaux, qu’ils ne soient pas inamovibles et qu’ils agissent dans un cadre hiérarchique.
Le Gouvernement est responsable de la politique pénale, qui préoccupe légitimement nos concitoyens. Cette politique suppose, pour sa mise en œuvre, des agents qui vont en assurer l’application uniforme sur tout le territoire.
Le parquet est l’outil de cette politique pénale à travers l’observation des circulaires pénales émanant de la Chancellerie. C’est d’ailleurs en raison de cette (nécessaire) dépendance à l’égard du pouvoir exécutif que la jurisprudence européenne refuse de voir dans le parquet français un organe juridictionnel.
Cette spécificité des membres du ministère public au sein de la magistrature, tenant au caractère hybride de leur mission - magistrat et agent de l’Etat placé dans une ligne hiérarchique - a conduit à les doter d’un statut particulier.
Leur discipline et leur avancement sont confiés à une formation du Conseil supérieur de la magistrature distincte de celle des magistrats du siège et disposant de pouvoirs moindres que ceux reconnus à ces derniers. Pour autant, les parquetiers, en leur qualité de magistrats, se voient reconnaitre des prérogatives. C’est ainsi qu’ils disposent de l’opportunité des poursuites.
Un équilibre avait été trouvé, mais il est aujourd’hui rompu.
En effet, la suspicion liée à la subordination (fût-elle plus théorique que réelle) du parquet au garde des sceaux a fait son œuvre. Le soupçon s’est insinué à propos de décisions du parquet d’engager des poursuites ou de ne pas le faire dans des dossiers à fort retentissement. Des questionnements se sont également fait jour quant au moment choisi par le parquet pour engager des poursuites, notamment dans les affaires politico-financières.
Pour rassurer, les pouvoirs du garde des sceaux ont été rognés, tant par les textes que par autocensure ministérielle : interdiction des instructions de ne pas poursuivre, interdiction des instructions ministérielles dans les affaires individuelles, renoncement du ministre à passer outre à un avis non conforme du CSM en matière de nomination des magistrats du ministère public.
Cette logique conduit à terme à une indépendance totale du parquet, calquée sur celle des magistrats du siège. L’émancipation du parquet atteint son point d’orgue lorsque, en 2021, le Procureur général près la Cour d’appel de Paris et le Procureur général près la Cour de cassation, de surcroît président du CSM parquet, tiennent publiquement des propos critiques envers le garde des Sceaux, leur supérieur hiérarchique.
SI la tentation est forte chez certains de mener cette évolution à son terme, en y voyant une conquête de l’Etat de droit, on peut penser au contraire qu’elle est porteuse de périls redoutables pour notre démocratie comme pour notre justice.
C’est l’inverse qu’il faudrait faire : mettre fin à la confusion des genres en réservant aux juges du siège la qualité de magistrat, ainsi que les prérogatives statutaires correspondantes.
Outre que les fonctions de poursuite et de jugement sont par nature distinctes, l’impartialité requise des unes et des autres doit être appréciée au regard de la finalité des missions : le juge manie la balance de la justice, le procureur est partie poursuivante dans le procès.
Dans nombre de pays, le Royaume Uni et l’Allemagne notamment, les fonctions de poursuite sont confiées à des agents n’appartenant pas à la magistrature. Il leur incombe de rassembler les preuves (dans le respect des droits de la défense), d’établir s’il y a eu ou non violation de la loi pénale et de saisir le juge lorsque doivent être prises des mesures d’enquête portant atteinte à la liberté ou lorsqu’est venu le moment de juger.
La transposition de ce modèle en France est souhaitable.
Il conduirait à un nouveau parquet, dépendant du Gouvernement. Les fonctions de poursuite s’inscrivent en effet dans la mise en œuvre d’une politique pénale.
Le fait que cette politique soit définie par le pouvoir politique préserve la justice des risques inhérents à l’apesanteur d’un entre soi coupé de la société et livré à l’arbitraire de chaque procureur appliquant la loi en fonction de sa propre conception de l’intérêt général.
Ces considérations conduisent à écarter l’idée d’un Procureur de la Nation indépendant du pouvoir politique. Sa légitimité ferait vite débat : où trouver cette personnalité incontestable incarnant le bien public, ce caractère trempé mais bardé de lucidité et d’équanimité, cet être providentiel ? Le choix italien de l’indépendance totale du parquet produit une justice si déboussolée et si critiquée que sa réforme est à l’ordre du jour.
Sauf à se résoudre à vider l’Etat de sa substance régalienne, il convient de lui donner les moyens de s’acquitter de sa mission première : la défense de l’intérêt général. Dans le domaine pénal, cette mission implique la définition et la mise en œuvre de la politique pénale, dont il est comptable à l’égard des citoyens.
A cet égard, distinguer, comme aujourd’hui, les directives générales laissées au garde des sceaux et les dossiers individuels laissés aux parquetiers n’a guère de sens.
Une politique pénale se juge à ses résultats sur le terrain, à sa déclinaison dans les affaires particulières. Comment ignorer en outre que des affaires particulières peuvent poser des questions générales ?
Les fonctionnaires qui constitueraient ce ministère public séparé du siège disposeraient bien sûr, comme leurs homologues allemands, d’une indépendance fonctionnelle.
Ils se verraient conférer un statut protecteur spécifique, au centre duquel serait placée l’exigence de transparence, c’est-à-dire l’obligation stricte, pour le ministre de la Justice, de n’intervenir que par des instructions écrites. La clarification qui en résulterait contribuerait à une meilleure compréhension de l’institution judiciaire, de son rôle, de ses rapports avec les autres pouvoirs.
Elle permettrait d’asseoir sur des bases plus saines la séparation des pouvoirs.
Gazette n°11-Mars 2023
La gazette n°11 de la SPANAH est sortie.
Vous pouvez la lire ou la télécharger en cliquant sur le lien ci dessous :
Gazette n°10-DECEMBRE 2022
La gazette n°10 de la SPANAH est sortie.
Vous pouvez la lire ou la télécharger en cliquant sur le lien ci dessous :